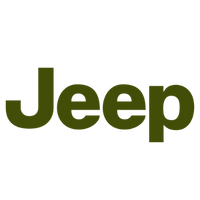Il y a un an, j’ai choisi de tourner la page et de laisser le diesel derrière moi. J’ai acheté une Tesla Model 3 Propulsion et, depuis lors, ma source d’énergie est devenue le kilowattheure. Après douze mois d’utilisation quotidienne, entre déplacements, essais en conditions extrêmes et recharges à domicile, je peux enfin dresser le bilan.
Le scepticisme initial
Avant l’achat, j’ai dû affronter le cortège d’avertissements d’amis et de famille. La plus sceptique était ma sœur, ancienne propriétaire d’une Renault Zoe, revenue au moteur thermique après une expérience peu enthousiasmante. Elle me disait que, en hiver, je ne pourrais pas utiliser le chauffage sans diminuer l’autonomie et que je passerais plus de temps à chercher des prises de courant qu’à conduire.
Pourtant, sur le papier, les avantages étaient évidents : silence, moindre impact environnemental, coûts d’exploitation réduits et une conduite plus fluide. Bien sûr, l’autonomie annoncée ne pouvait pas rivaliser avec celle d’une voiture à essence, mais l’idée de recharger à domicile changeait complètement les règles du jeu.
Autonomie : mythe ou réalité ?

Selon les données du Service statistique du Ministère de l’Environnement, un automobiliste parcourt en moyenne 36 km par jour. Une valeur qui correspond parfaitement à mes habitudes. Dans cette optique, une batterie de 1000 km serait un gaspillage de poids et de ressources : 400-500 km réels suffisent pour couvrir la majeure partie des déplacements, à condition de pouvoir compter sur des recharges rapides.
Les Superchargeurs Tesla ou les bornes Ionity, par exemple, permettent de récupérer des centaines de kilomètres en quelques minutes, rendant inutile l’obsession pour l’autonomie maximale.
La question de la recharge

Avant d’installer une wallbox à domicile (coût entre 1 200 et 1 600 €, avec installation certifiée IRVE), j’ai utilisé pendant six mois les bornes publiques. Dans les centres commerciaux, je trouvais souvent des points gratuits ou peu coûteux. Aujourd’hui, avec ma Tesla Wall Connector, une recharge complète prend 6–8 heures sur une puissance de 7 kW : il suffit de brancher la voiture le soir pour la retrouver chargée au matin.
Coûts et économies réels

En 2022, mon contrat EDF à tarification par créneau fixait le prix du kWh pendant les heures creuses à 0,147 €. Une « recharge complète » de 60 kWh coûtait donc moins de 9 €, pour une autonomie réelle d’environ 350-400 km.
Sur une base annuelle, en parcourant 20 000 km, j’ai dépensé environ 400 € d’énergie, contre les 2 500 € que j’aurais dépensés en diesel avec ma précédente DS3. Une économie estimée à 2 100 €.
Voyages et imprévus

J’ai condui en montagne avec 10 cm de neige, sous une pluie battante et dans le vent : la voiture n’a jamais connu de soucis. L’hiver réduit l’autonomie de 15 à 20 %, mais le pré-conditionnement de la batterie, programmable via l’application, limite les pertes.
Bien sûr, tout n’est pas parfait : dans certaines zones, comme le centre et le sud-ouest de la France, le réseau de recharge rapide reste insuffisant. Lors d’un voyage à Aurillac, les trois bornes de 50 kW étaient hors service, m’obligeant à une longue attente sur une prise plus lente.
Comprendre kW et kWh
Passer à l’électrique signifie aussi apprendre un nouveau langage.
- kW (kilowatt) = unité de puissance (1 kW ≈ 1,36 CV). Ma Tesla développe environ 240 kW, soit environ 325 CV.
- kWh (kilowatt-heure) = quantité d’énergie disponible. C’est l’équivalent du « litre de carburant » pour une voiture thermique : plus il y a de kWh, plus on peut parcourir de kilomètres.
Revenir au thermique ? Impossible



Après un an, je n’ai aucun doute : je ne reviendrai jamais à une voiture à essence ou diesel. La fluidité de conduite, les économies réelles et la possibilité de recharger à domicile font de l’électrique un choix logique et agréable. Le chemin vers une infrastructure complète est encore long, mais la direction est claire. La voiture électrique, pour moi, est le présent qui anticipe l’avenir.